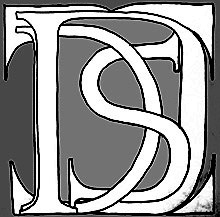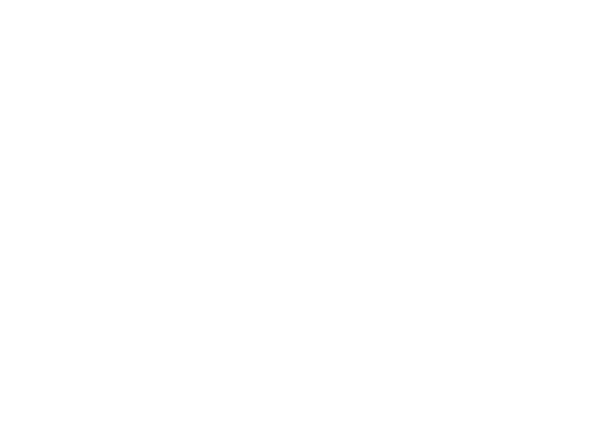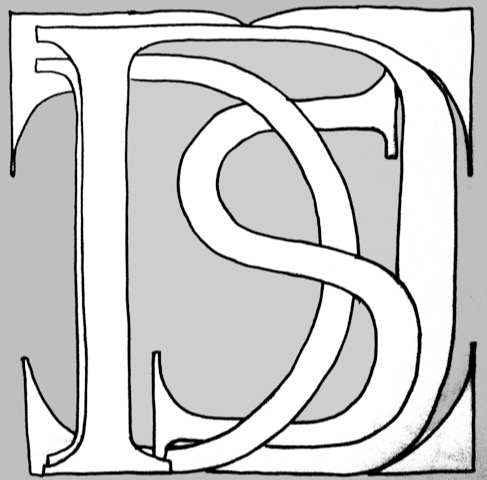…/ Je pris dans chaque main — et non sous mon bras — une main du couple et le remorquai jusqu’à la sortie du jardin sur le chemin de Flachsenfingen ! Je me forçais souvent tandis que je marchais entre eux à tourner la tête comme si j’entendais quelqu’un nous suivre; mais en réalité je voulais encore une fois (encore qu’avec mélancolie) regarder en arrière vers l’heureux petit village qui ne se composait que de demeures d’une tranquille et satisfaite joie de sabbat et qui est suffisamment heureux (quoique sur ses pavés espacés passent seulement toutes les semaines un barbier, tous les jours de fête un coiffeur et tous les ans un crieur de parasols). Ensuite il me fallut de nouveaux tourner la tête et regarder les deux heureux avec des yeux qui se remplirent bientôt de larmes…/…

Finalement nous arrivâmes à la colline -frontière au-delà de laquelle on ne pouvait laisser aller Thiennette et il me fallut alors me séparer de mon compère avec lequel j’avais causé si joyeusement tous les matins, — chacun de nous du fond de son lit— et quitter le cercle tranquille de nos modestes espoirs pour reculer dans le cercle bouillonnant et aboyant où on arrache au destin, à force de menaces et d’exigences, un bout de réglisse de la grosseur d’un bras — telle la réglisse botanique qui pousse le long de la Volga — moins pour en mâcher les douces tiges elles-mêmes que pour en assommer les autres. Lorsque je pensais que j’allais leur dire adieu, toutes les souffrances futures, tous les cadavres et tous les désirs de cet attelage aimé se présentaient à mon cœur et je songeais que rien ne jalonnait le jour de leur vie (comme le mien et celui de chacun) que des fleurs de joie endormies. — Et pourtant il est beau qu’ils comptent leurs années, non d’après la clepsydre de larmes qui tombent mais d’après l’horloge florale (Linné installa à Upsala une horloge florale dont les fleurs indiquaient l’heure d’après les différents moments où elles s’endormaient. ndlr) où s’endorment les fleurs dont les calices se ferment d’heure en heure, hélas ! devant nous, pauvres hommes. Je voudrais maintenant — parce que je me souviens encore de la manière dont je me penchai au-dessus de ces deux êtres chers comme au-dessus de deux cadavres avec des yeux ruisselants — m’adresser la parole à moi-même et me dire : beaucoup trop tendre Jean-Paul, toi dont la craie reproduit toujours sur le crêpe de la mélancolie les modèles de la nature, endurcis ton cœur comme ton corps pour ne pas t’user ni en user d’autres par le frottement. Mais pourquoi dois-je le faire, pourquoi ne pas confesser sans ambages ce que je dis dans l’attendrissement le plus ému à ces deux êtres ? ‘ Que tout aille bien pour vous, doux amis — dis-je, car il n’était plus question pour moi de politesse — que la providence porte dans ses bras berceurs vos cœurs déchirés — que le Dieu bon qui règne par-delà ces soleils qui maintenant abaissent sur nous leurs regards vous laisse toujours unis et vous élève vers son cœur et sa bouche sans vous séparer’. Nous tombâmes tous dans un attendrissement exagéré. Nous nous arrachâmes enfin à des étreintes répétées et mon ami disparut avec l’âme aimée — je restai tout seul dans la nuit. Alors je marchai sans but, franchissant des forêts, des vallées et des ruisseaux, traversant des villages endormis pour jouir de la grande nuit comme d’une belle journée.

Jean-Paul (1763-1825) – Vie de Fixlein // Caspar Friedrich – Le soir // Sur mon chemin ce soir, 28-12-18